A - La testostérone
I - La testostérone endogène
1.
Qu’est ce que la testostérone ?
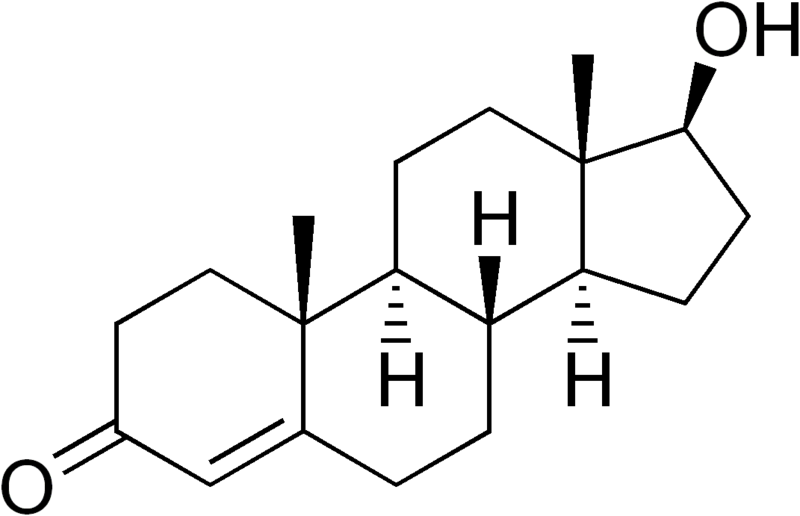
C19H28O2
La
testostérone est une hormone
stéroïdienne
naturellement présente en grande quantité chez
l’homme
et en plus faible quantité chez la femme. Elle est dite endogène
c'est-à-dire fabriquée naturellement
par le corps par des glandes spécifiques chez les deux
sexes.
La testostérone a donc des fonctions très
variées, elle influe sur :
-
Le comportement sexuel
-
La définition des caractères sexuels secondaires (pilosité, taille du pénis …)
-
Le développement de la masse musculaire,…
Mais la prise de testostérone exogène peut entraîner :
-
Des troubles comportementaux (agressivité)
-
Des troubles sexuels (impuissance, stérilité, réduction de la taille du pénis expliqué par le rétrocontrôle négatif : l’excès de testostérone entraîne une diminution de la production de GNRH et de LH)
-
Des troubles immunitaires
-
Des blessures accrues (ruptures tendineuses).
-
Des troubles de la santé (effet oncogène c'est-à-dire risque de cancer)
-
Une dépense énergétique accrue.
Schéma récapitulatif des effets de la prise de testostérone exogène
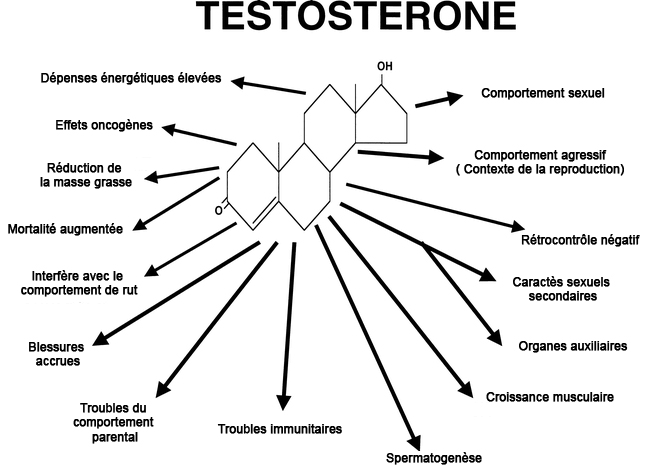
2.
Synthèse et régulation de la
testostérone.
a.
Synthèse de la testostérone
La
production journalière de testostérone chez
l’homme
varie de
2.5mg à 10mg.
Elle est d’environ 0.25mg
par jour chez la femme.
Chez l’homme, les cellules
de Leydig
présentes au niveau du testicule produisent 95% de la
testostérone. Le reste est produit part les
glandes
surrénales.
Chez
la femme, la production de la testostérone est
assurée
par les
ovaires et les
glandes
surrénales.
A
noter que chez la femme enceinte, il existe une production de
testostérone au niveau du placenta.
Au
niveau de la synthèse biochimique, la
testostérone est
métabolisée à partir du cholestérol.
Il
existe deux voies de synthèse de la
testostérone :
-La
voie prépondérante est celle passant par la
transformation de la prégnénolone en
progestérone
puis sa métabolisation en androstènedione,
précurseur
de la testostérone.
-L’autre, minoritaire fait se
transformer le cholestérol en
prégnénolone puis
en DHEA avant d’être
métabolisé en
androstènedione et enfin en testostérone.
b.
Régulation de la testostérone
La
testostérone est soumise à des
mécanismes de
régulation
permettant de maintenir son taux sanguin, ou
testostéronémie,
à une même valeur globalement constante.
Cette
régulation fait intervenir :
-
La production de testostérone, elle-même régulée par l’axe hypothalamo-hypophysaire.
-
La pénétration de la testostérone dans les cellules qui la métabolisent.
-
La dégradation de testostérone qui se produit en permanence et qui est éliminée dans le foie et les urines.
Ce système de régulation permet un équilibre dynamique.
Lorsque
la testostéronémie diminue, des capteurs au
niveau de
l’hypothalamus détectent ces faibles
concentrations. Les
neurones hypothalamiques secrètent alors de façon
pulsatile la neuro-hormone : la
GnRH.
Cette dernière est ensuite véhiculée
jusqu'à
l’hypophyse qu’elle stimule.
Les cellules hypophysaires vont produire des hormones
gonadostimulines : La
FSH et la LH
qui contrôlent
le fonctionnement testiculaire. La LH agit sur les cellules de Leydig
en stimulant la sécrétion de
testostérone. La
FSH agit sur les cellules
de Sertoli
des tubes séminifères : elle est
indispensable au
déroulement complet de la spermatogenèse.
Ce système en cascade a une signification physiologique
d’amplificateur,
en effet quelques picogrammes de GnRH vont entrainer la
sécrétion
de quelques nanogrammes de LH qui vont à leur tour permettre
la sécrétion de quelques microgrammes de
testostérone.
A l’inverse, lorsque la testostéronémie
augmente, se produit une diminution de la
sécrétion de
GnRH par l’hypothalamus. Ceci entraine une diminution de la
sécrétion de FSH et de LH hypophysaire. Ainsi le
testicule est moins stimulé ce qui se traduit par une
diminution de la sécrétion de
testostérone.
L’axe
de régulation hypothalamo-hypophysaire
permet donc de maintenir la testostéronémie
à
une valeur constante.
Cependant,
d’autres mécanismes peuvent également
intervenir. En
effet des messages nerveux issus de l’environnement
(lumiére)
ou de l’individu (état psychologique) peuvent
également
intervenir dans la sécrétion hypothalamique de
GnRH.
Coupe transversale de l’encéphale
Schéma de la régulation de la testostéronémie
Schéma de la régulation de la testostéronémie